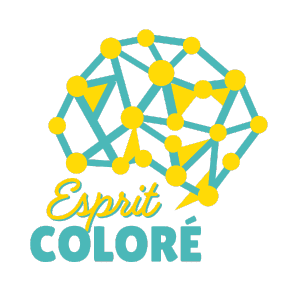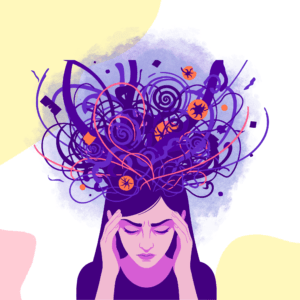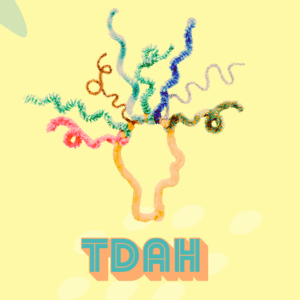Prendre soin de ceux qui prennent soin
Dans quel état voulons-nous que soit la personne qui s’occupera de nous quand nous serons le plus vulnérables ?
Quand elle gérera nos médicaments.
Notre corps.
Notre nourriture.
Quand elle sera, peut-être, la seule encore là pour nous aider.
Cette question n’est pas théorique. Elle dit quelque chose de très concret sur la manière dont nous pensons le soin, l’accompagnement, l’éducation, la protection.
Un paradoxe collectif
Nous confions ce que nous avons de plus précieux à d’autres personnes.
Nos enfants, chaque jour, à des enseignant·es ou à des professionnel·les de la petite enfance.
Nos parents vieillissants ou fragilisés à des soignant·es, des aides, des accompagnant·es.
Et, dans les moments les plus critiques, des personnes victimes de violences, de traumatismes ou de ruptures à des professionnel·les du soutien et de la protection.
Autrement dit : aux moments les plus vulnérables de la vie, nous dépendons profondément d’autres humains.
Et pourtant, dans le même temps, nous acceptons que celles et ceux qui prennent soin, qui accompagnent, qui protègent, travaillent dans des conditions de plus en plus difficiles.
Sous-effectif chronique.
Fatigue structurelle.
Manque de reconnaissance.
Pression constante.
Ce n’est pas un reproche.
Ce n’est pas une accusation.
C’est un paradoxe.
Un paradoxe révélateur de la valeur que nous accordons à celles et ceux qui prennent soin.
D’un côté, nous affirmons que ces métiers sont essentiels.
De l’autre, ils sont parmi les plus fragilisés de notre société.
La vocation comme compensation.
Pour que ce paradoxe tienne, nous avons construit un récit très puissant :
celui de la vocation.
La vocation comme compensation.
Comme si aimer son métier pouvait remplir le frigo.
Compenser les horaires impossibles.
Réparer le temps passé loin de chez soi.
Absorber la violence de certaines situations — parfois même les insultes.
Suffire là où les moyens manquent.
Comme si le sens devait remplacer le salaire.
Comme si l’engagement devait être, en soi, une récompense suffisante.
Mais aimer prendre soin ne protège pas de l’épuisement.
Aimer son métier ne rend pas invulnérable.
Et le sens, aussi fort soit-il, ne remplace ni le repos, ni la sécurité, ni la reconnaissance.
Il ne s’agit pas de remettre en cause l’engagement de celles et ceux qui exercent ces métiers.
Il s’agit simplement de reconnaître que l’engagement ne peut pas être la seule réponse.
Notre vulnérabilité partagée
Ce paradoxe devient encore plus visible quand on accepte de regarder une autre réalité, plus silencieuse : notre propre vulnérabilité.
Nous pouvons tous, un jour, nous retrouver dans une situation où nous dépendrons entièrement de quelqu’un d’autre.
Une maladie.
Un accident.
Un âge qui avance.
Un moment où l’on ne peut plus faire seul.
Imagine : tu te réveilles à l’hôpital après une opération. Tu as mal, tu es désorienté·e, tu ne sais pas où sont tes affaires. La personne qui entre dans ta chambre à ce moment-là — aide-soignante, infirmier — c’est elle qui va déterminer si tu te sens en sécurité ou abandonné·e. Si tu oses demander de l’aide ou si tu te fais tout petit. Si tu pleures de soulagement ou de solitude.
Cette personne, dans quel état voulons-nous qu’elle soit ?
Dans ces moments-là, ce que l’on espère, très simplement, c’est avoir en face de soi une personne présente, disponible, en pleine possession de ses moyens.
Quelqu’un qui tient.
Quelqu’un qui a encore de l’énergie, de la motivation, des ressources.
Non pas parce qu’elle serait « exceptionnelle »,
mais parce que ses conditions lui permettent encore de l’être.
La qualité de l’aide dépend aussi, très concrètement, de l’état de celles et ceux qui aident.
Ce que cela dit de la valeur que nous accordons à nos proches
Ce paradoxe est d’autant plus frappant que nous parlons ici de l’enfance, de la vieillesse, de la maladie, des victimes, des populations fragilisées.
Autrement dit, de ce que nous avons de plus fragile… et de plus précieux.
On ne peut pas dire que nos proches comptent plus que tout
et considérer comme secondaires les personnes qui veillent sur eux chaque jour.
La manière dont une société traite les métiers du soin, de l’éducation et de l’accompagnement
dit beaucoup de la valeur qu’elle accorde à la vulnérabilité humaine.
« Crise des vocations » ou crise de cohérence ?
C’est souvent à ce moment-là que l’on parle de « crise des vocations ».
Mais peut-être faudrait-il déplacer le regard.
Quand des métiers essentiels deviennent épuisants, précaires et peu soutenus,
ce n’est pas la vocation qui disparaît.
Ce sont les conditions qui rendent l’engagement impossible à tenir dans la durée.
Il n’y a là rien de mystérieux.
Ce n’est pas une défaillance individuelle.
C’est une conséquence logique.
Conclusion
Reconnaître ces métiers n’est pas une question de générosité.
Regarder ce paradoxe en face ne demande ni héroïsme, ni culpabilité.
Cela demande simplement de la cohérence.
Car la manière dont nous prenons soin de celles et ceux qui prennent soin dit beaucoup de la société que nous construisons, et de la place que nous faisons à la vulnérabilité humaine.
Alors, concrètement ?
Peut-être que ça commence par des petites choses : regarder vraiment la personne qui s’occupe de ton parent en EHPAD. Dire merci à l’enseignant.e de ton enfant — pas une fois par an, régulièrement. Ne pas considérer comme normal que l’auxiliaire de vie enchaîne les journées de 12 heures.
Et si tu fais toi-même partie de ces personnes qui prennent soin — si tu te reconnais dans cette fatigue qui ne dit pas son nom — peut-être que la première étape est simplement de reconnaître que tu as le droit, toi aussi, d’être soutenu·e.
L’engagement ne suffit pas.
Il nous faut aussi des relais, du repos, et des espaces pour déposer ce qu’on porte.
RESSOURCES
Trouver de l’aide et une oreille attentive
Contenus à découvrir sur le burn-out féminin